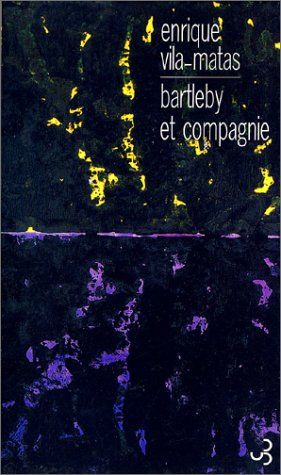Georges Pierre, décédé ce dimanche, avait publié au début de l’année 2012, dans l’un des blogs qu’il répudierait plus tard, une chronique du plus bel effet. Il donnait un bref compte-rendu de l’œuvre d’Antoine Cantard, un français exilé à Buenos Aires qui avait abandonné toute activité littéraire non-numérique au milieu des années 2000.
Il avait dû raisonner de la manière suivante, jugeait Pierre en substance. La littérature est faite pour nous permettre de nous sentir moins seuls. A cet égard, le roman n’accomplit sa fonction qu’à moitié. Car s’il peut parfois sembler au lecteur qu’il découvre dans une œuvre des mots qu’il aurait toujours voulu lire, des personnages qu’il aurait toujours voulu rencontrer, et qu’il s’entretient ainsi avec des esprits et des cœurs familiers, l’auteur, de son côté, comme en témoigne la correspondance de Flaubert à Louise Colet, souffre le martyre pour produire cette semblance de vie, et ne se trouve jamais aussi seul que portant sa pierre grosse ou petite à l’édifice de rencontre en papier que l’on appelle littérature. La littérature est la vie pour ceux qui la lisent, la mort pour celui qui l’écrit. Tant que cette phrase sera vraie, avait dû juger Antoine Cantard, l’auteur masochiste ne vaudrait pas mieux que le pélican peu malin qui, faute de savoir pêcher correctement, se voit contraint d’offrir son cœur en pâture à ses petits frappés d’inanition.
Il y avait deux éléments remarquables dans l’itinéraire de Cantard. Le premier était l’abandon de toutes les formes littéraires hormis le genre épistolaire. L’autre, la décision abrupte, démentie une seule fois, de s’abstenir de tout autre support de rédaction que celui que lui offrait Google Mail. Jusque-là, il s’était acharné à produire un roman qu’il voulait sincère et nouveau. L’examen du disque dur de l’ordinateur qu’il utilisait avant d’envoyer ses premières lettres nous dirait beaucoup à son sujet. Malheureusement, selon les témoins qu’a pu interroger Georges Pierre, cette nouvelle orientation littéraire avait précédé de très peu l’abandon de la machine sur le banc d’un parc du quartier de Barracas, dans la capitale argentine, à côté d’une maison patricienne en ruine. Il s’agissait d’un ordinateur portable écran 15 pouces, de la marque Asus, à l’armature de faux bambou. Ces précisions n’ont jamais permis de retrouver le précieux objet et, quarante ans après, publiant cette chronique, nous suggérons à qui disposerait d’informations utiles de se manifester auprès de la Centrale Européenne d’Etudes sur la Fin de Littérature, département Pierre. Quoi que l’on puisse découvrir cependant, l’enrichissement anecdotique ne saura pas se comparer à l’apport principiel de Cantard, dont les vastes perspectives ont été soulignées par l’étude fondatrice de notre ex-critique.
Selon ses meilleurs amis parisiens de l’époque, qu’il cessa de voir suite à sa conversion, s’il est permis d’employer ce terme un peu solennel pour parler de la nouvelle forme qui allait affecter son écriture, le roman de Cantard devait consister en centaines de pages consignées au format Word, de facture frénétique et décousue. Il leur manquait le début et la fin. Certaines séquences métatextuelles comparaient l’immersion dans l’écriture à une plongée dans le néant. Les rares personnes qui ont pu avoir accès à des éléments partiels de l’œuvre projetée parlent d’un récit au fond assez conventionnel, inspiré du roman réaliste, mais débridé au point de vue de l’invention. Le style empruntait beaucoup à Beckett, même si la sécheresse des phrases était tempérée par un usage non-ironique de la répétition, et que quelques moments d’ironie inoffensive, légère, rappelaient les récits courts de Gérard de Nerval. Une femme que Georges Pierre soupçonne de n’être pas tout à fait impartiale le concernant prétend par ailleurs que, malgré les nombreux ajouts dûs à l’imagination débordante de Cantard, notre récit était la mise en scène sub spaecie aeternitatis, lyriquement scandée, d’un événement hasardeux mais réel survenu au début d’une relation amoureuse vouée à l’échec. Elle ajoute que Cantard ne se serait jamais remis de ce qui lui arriva et que, de ce jour, il aurait commencé à s’intéresser aux contes fantastiques, avant de devenir parfaitement fou et d’aller vivre comme un vagabond à Buenos Aires.
Georges Pierre veut bien admettre la première partie de ce témoignage, mais il conteste absolument l’incurabilité de Cantard. D’ailleurs, si l’œuvre du second Cantard n’interdit pas d’imaginer un vagabond, une lecture plus attentive rend cette conjecture extrêmement peu plausible. Il eût fallu qu’il inventât tous les passages où il évoquait, légèrement certes, son activité professionnelle. En fin de compte, ce ne serait pas la folie, justement, mais le comble, non-même du bon sens, mais de la sagesse, qui l’amena à délaisser Paris pour Buenos Aires. « Cantard est notre dernier Rimbaud, écrivait Georges Pierre dans sa méditation de 2012, puisque, même s’il ne sera pas le dernier à avoir cherché sincèrement l’absolu en littérature, il est aussi le premier à avoir trouvé une manière nouvelle de la faire exister, loin de cette déception, et pourtant sans ironie aucune. » Certains sont revenus plus tard sur l’exactitude historique de ces propos, mais Georges Pierre fit remarquer que le plus important en eux était leur pathétique, et que, quoi que l’on ait à redire par ailleurs, il exprimait là ce que l’événement avait eu de lumineux et de définitif pour les rares personnes qui eurent l’occasion de lire les productions de Cantard au début du siècle où nous écrivons.
Antoine Cantard, fort du raisonnement reconstitué ci-dessus par Georges Pierre, considéra un jour qu’il se promenait dans Buenos Aires qu’une écriture néanmoins pouvait échapper aux impasses solitaires de l’œuvre romanesque à cause de laquelle, à Paris, il ne voyait plus personne, était sale, et avait vu croître selon une proportion inadmissible sa propension à la paranoïa. Il fit le récit de l’événement, sans le présenter nullement comme une transformation révolutionnaire. Mais, du petit appartement qu’il louait Avenue Hipólito Yrigoyen, il cessa un jour de noircir les pages blanches pour lesquelles il s’était exilé, et écrivit une lettre. C’était un jour de grand vent. Il avait plu le matin, d’une averse violente et sauvage comme l’été portègne en offre maints exemples, puis le soleil était venu. Ne sachant trop pourquoi, il avait décidé de quitter le deux-pièces sombre et il avait passé plusieurs heures à flâner, descendant par l’avenue Corrientes jusqu’à l’obélisque, puis obliquant à droite, et ralliant les docks de brique du quartier de Puerto Madero, dont les barres sont d’un effet aujourd’hui des plus glauques, mais qui brillait alors de tout l’éclat, minable certes, mais tout à fait luisant, de la nouvelle oligarchie.
Ce quartier nouveau lui donnait une impression de solitude qui ne lui était pas connue. La ville, d’ordinaire bourdonnante, lui suggérait soudain le besoin pressant de rentrer dans le calme de son appartement. Mais cette fois, c’était l’inverse. Ce calme, et le grand vent qu’il faisait ce jour-là, lui suggéra de rebrousser chemin, non pour rentrer en lui-même, dans les soubassements fantomatiques et sublimes de sa conscience, non, mais pour aller simplement écrire une lettre. Il la commença en récapitulant l’argument d’un vieux morceaux des Ad familiares de Cicéron, ou alors de Pline le Jeune, que son professeur de latin, dans des années de lycée heureuses et parfois regrettées, lui avait fait traduire. Il expliqua à son interlocuteur qu’il se sentait nostalgique de ce bel équilibre antique, de ces hommes satisfaits pour qui c’était assez de s’adresser à l’intelligence et aux cœurs de ceux qui leur étaient chers et d’attendre une réponse, sans se poser la question de savoir s’ils seraient un jour honorés comme les révélateurs des troubles de la condition humaine, ou les porteurs de son espoir, espoirs et troubles faits d’un infime soupçon de raison et de beaucoup de délires, ce qu’il s’acharnait à reproduire dans son interminable roman. Il dit cela simplement, ce fut tout. Mais toutes les fondations du monde qu’il admirait tremblèrent ce jour-là. A partir de ce moment, tout s’enchaîna très vite.
Il semblerait que ce soit dix jours après ce courrier fort simple que Cantard jeta l’ordinateur. Il n’en fit jamais mention dans aucune lettre. Il disait simplement « quelqu’un parle fort dans la cabine téléphonique située à côté de moi », ou « je fais résonner le clavier usé du cybercafé alors que je t’écris ». Une autre fois, il fit remarquer qu’à la suite d’une fausse manipulation, tout son message s’était effacé, et qu’il lui fallait recommencer. « C’est la seule chose qui me fasse regretter Word quelques fois, ajoutait-t-il. Il y a trois ans, je me souviens que tous mes documents étaient sauvegardés automatiquement et que nulle fausse manipulation ne me privait du fruit de mon travail. Voilà trois fois que je retape le même message, à quelques inévitables variantes près s’entend, parce que mon annulaire s’acharne à enfoncer le bouton backspace, et, le curseur étant mal placé, me fait revenir à la page précédente, ma boîte de réception Google. Impossible de récupérer quoi que ce soit. »
Jamais il ne faisait la théorie de rien. Il disait cela comme ça, en passant, il a fallu que Georges Pierre intervienne. Mais selon Pierre l’insistance que Cantard portait aux références antiques, la mention des œuvres de Sénèque, de Cicéron et de Pline, qui étaient devenus ses seuls ouvrages de chevet, comme le retour épisodique d’une évocation sobre de la beauté de la marche ne laissent planer aucun doute quant à, non pas son intention, mais simplement ses certitudes.
Il s’adressait à deux ou trois personnes par semaine. Aucune n’habitait Buenos Aires. Personne n’habitait Paris. Pierre reçut de Patrick McDonald, de Baltimore, quelques-uns des textes de Cantard. Antoine écrivait aussi à l’intention d’une jeune femme, domiciliée à Berlin, qui ne fut pas simple à trouver. C’est avec elle que ses textes avaient leur inflexion la plus intime. A Marseille, Jacques Marsoni avait quant à lui le privilège de susciter des productions d’une grande inventivité, où Cantard parlait peu directement de lui, peut-être intimidé par la politesse et l’intelligence de son ami, craignant de trahir des sentiments qui pourraient paraître grossiers, mais toujours préoccupé, sous des discours apparemment intellectuels, de partager les sentiments qui étaient les siens au quotidien. Le mot présence revenait souvent dans ses développements. Il insistait beaucoup sur la satisfaction simple et définitive que lui apportait ce partage de loin en loin, d’idées toujours fines, mais jamais bouleversantes, de sentiments qu’il se réjouissait d’exprimer simplement parce qu’ils étaient les siens.
Georges Pierre a largement commenté, dans son premier essai, ces deux éléments si caractéristiques, celui qui faisait de Cantard un écrivain à un seul registre, et celui qui faisait de Cantard un auteur nomade, n’inscrivant jamais sur le même support et ne conservant jamais d’éléments matériels de ses réalisations. Il semblait que, quand il avait réussi à transmettre quelque chose de lui, le courrier avait atteint son but. Il avait en outre, on pouvait le déduire de ses lettres, supprimé tout matériel informatique de chez lui. Cela lui permettait d’entretenir un culte moderne et modeste de l’écriture. D’ordinaire, il commençait par une courte promenade, puis il s’installait dans un café internet où il se mettait à rédiger, rarement plus de deux heures et jamais moins d’une heure et demie. Il n’expédiait par ailleurs jamais ses courriers le même jour, par principe semble-t-il. Si la littérature doit remédier à la solitude, nous explique Georges Pierre, alors son but est tout entier atteint quand elle nous a permis de communiquer, loin des obstacles induits par les conventions sociales (c’est pourquoi Cantard ne s’adressait qu’à des gens vivant en des lieux très éloignés les uns des autres et n’entretenant aucun rapport entre eux), loin aussi de la contrainte culturelle consistant à exiger d’un écrivain qu’il soit un auteur (c’est pourquoi il ne faisait aucune référence à aucune personnalité contemporaine ou même éternelle, comme c’est le cas dans ce genre d’écrit, et la raison pour laquelle il avait adopté un style peu soucieux de la correction sans être m’as-tu vu. Quand il mentionnait Pline ou Sénèque, ce n’était pas comme de sages qu’il en parlait, ni même comme d’individus prestigieux. Au fond, on pouvait même se demander s’il s’agissait là à ses yeux de personnes. Il disait : « dans le petit volume qui se trouve à côté de mon lit, j’ai lu la phrase suivante » au même titre que « une affiche publicitaire de l’avenue Boedo dit » ou « j’ai entendu à la radio hier soir que ». Cela, bien sûr, s’accentue dans les lettres de la maturité. La première, nous l’avons vue, était encore un peu entachée de culture. ) Il est absolument essentiel aux yeux de Georges Pierre qu’Antoine Cantard se soit débarrassé de son ordinateur, comme le fait qu’il écrive toujours sur des postes loués, dans plus d’une quarantaine de cybercafés portègnes, où il avait pourtant ses réguliers. Car, même si Cantard parle de la dureté du travail et des problèmes de la subsistance dans certaines de ses lettres, la parcimonie qu’il met dans l’évocation de ces thèmes difficiles laisse à ses correspondants et lecteurs l’impression d’un homme néanmoins profondément libre, affranchi de toute angoisse, qui suscite chaque fois qu’il se manifeste une émotion qui n’a rien de violent, mais qui mêle de la manière la plus douce un peu d’humour, de quiétude, de joie et une pointe de tristesse, ingrédient homéopathique indispensable à un bonheur tout à fait accompli.
Selon Georges Pierre, les amis portègnes d’Antoine Cantard, dont les noms figurent régulièrement dans les courriers, ne se sont jamais doutés de l’être avec lequel ils passaient leurs fins de journée, leurs matinées, ou même leur nuit pour certaines parmi eux. Antoine Cantard avait le vœu d’être tout entier attaché à ce qu’il faisait là-bas, et rien ne lui aurait été plus insupportable que d’adopter la posture de l’homme de lettres contraint aux nuits blanches ou même aux après-midi de réclusion. Nous trouvons là sans doute la raison de la courte durée de ses moments de rédaction. Non en volume, il lui arrivait d’envoyer des messages de plus de 8000 signes dans le bref intervalle qui lui était imparti. Mais il n’aurait pas supporté l’idée que l’on pût voir dans ses absences intermittentes autre chose qu’un inoffensif désir de se promener. C’est bien là, au fond, exactement ce qu’étaient ses écrits, pour reprendre le mot de Georges Pierre, des ballades. La durée de rédaction, comprise entre 1h30 et 2h, comme on peut le déduire des indications qui parsèment chacune de ses lettres, relativement à la situation d’énonciation, ainsi que le climat de la ville et le charme bizarrement hospitalier des cafés internet expliquent, sans doute, nombre des secrets de sa prose.
Passé la fin de 2014 sa trace se perd. Le second Cantard aura exercé sept années. Faut-il y voir un symbole ? Selon Georges Pierre, c’eût été très contraire à l’esprit de cette œuvre sobre et pour cette raison même hors du commun. Il se refusait aussi à croire en un abandon arbitraire de la littérature. Après des vœux de nouvelle année adressés aux trois correspondants, plus un courrier ne leur parvint. Il aurait été facile d’enquêter sur ce silence et de chercher à savoir s’il fallait l’attribuer à la mort ou à un autre accident brutal et dramatique. Pierre, comme les trois correspondants de Cantard, furent d’avis que c’eût été mal interpréter l’œuvre de leur camarade que de se scandaliser de cette disparition. L’exercice de Cantard se devait d’être fugitif. Sans doute n’y avait-il eu qu’un événement mineur, empêchant la poursuite de l’activité, ou alors, simplement, le meilleur moyen de prolonger les lettres avait-il été d’indiquer un bonheur si parfait qu’il lui était possible de recourir à ou de se passer de l’écriture à volonté, selon les impulsions momentanées.
Peu après la fin de l’activité d’Antoine Cantard, Georges Pierre décida de renoncer à toutes ses publications à prétention esthétique. Il ferma le blog qu’il animait depuis quatre ans, Le Tableau blanc, et retira ses contributions aux diverses revues dilettantes qui l’accueillaient. Ce n’était pas un sentiment de culpabilité ou la vague conscience d’une forme de grossièreté qui l’accablait, mais le sentiment soudain inéluctable qu’Antoine Cantard devait continuer d’exister, sinon sous ce nom, du moins dans l’idée. L’être qui se chargerait de reprendre la vocation ne devait pas compromettre la légèreté de la pratique cantardienne avec d’autres rédactions à ambition artistique, certes, mais entachée de travail. Il fallait le même non-lieu, le goût de la promenade, la règle des deux heures et du café internet. Pierre se déplaça à Buenos Aires, ne se départit pas de son matériel informatique, mais ne recourut jamais à son ordinateur personnel pour son activité d’écrivain. Il exerça le métier éminent d’universitaire quarante années durant, jusqu’au jour funeste qui nous priva de ses lumières. Comme écrivain, il est l’auteur de plusieurs milliers de pièces épistolaires.
Bibliographie
Il n’existe pas de recueil des œuvres d’Antoine Cantard. Pierre, les trois correspondants et les quelques lecteurs privilégiés sous les yeux desquels passèrent les caractères de notre cher visionnaire se refusèrent à imprimer les messages, pensant que ce serait trahir la portée de ces réalisations que de leur donner un être de papier. Ils poussèrent le fétichisme jusqu’à écarter la possibilité de détenir les lettres sur disque dur, et, les laissant au bon soin des serveurs en ligne respectifs, constatèrent un beau jour que le produit avait disparu, en raison du dépassement des délais réguliers de la conservation. On sait que, dans l’une d’entre elles, il imaginait la vie d’un petit réparateur automobile de la pampa, dont l’existence ne consistait en rien d’autre que l’attente du passage de camions à pneus crevés. Dans une autre, il se référait à Borges comme au plus grand sage de l’humanité. Mais il devait en son for intérieur se croire encore un petit peu supérieur à lui, et c’est sa pudeur qui l’empêcha toujours de se mettre en avant à cet égard.
Georges Pierre s’est risqué à publier certains de ses courriers dans une revue en ligne, question d’écritures. Il a par ailleurs arrangé avec googlemail un contrat de conservation de cent ans pour l’intégralité des pièces figurant sur son compte électronique. Comme ces ressources immenses n’ont pas encore été écumées, toute personne inspirée par les lignes précédentes et souhaitant participer aux travaux de recollection des œuvres complètes est priée de s’adresser à nous via les coordonnées suivantes. Il en va de notre intérêt patrimonial à tous.
Centrale Européenne d’Etudes sur la Fin de la Littérature, département Pierre, Secrétariat de la Communication. Écrire à : littératurefindessiècles@ceefl.be
(Samuel)